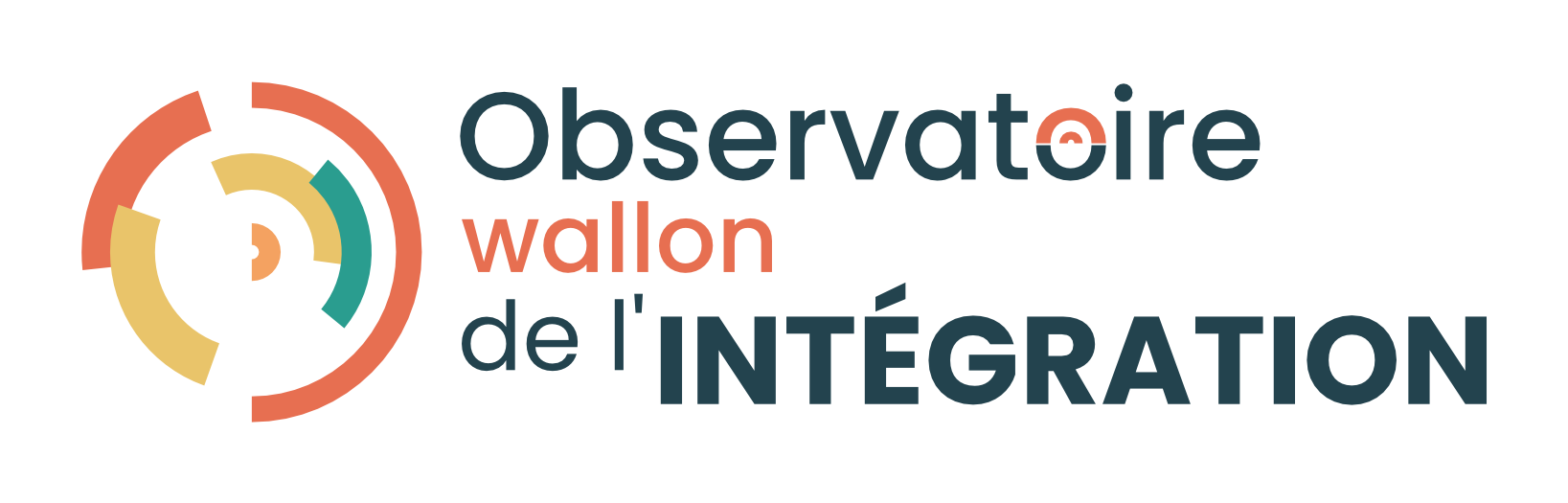Les rapports ambigus entre sexualité, genre et religion pour la femme dans le contexte de l’islam
Comment évoluent les rapports entre hommes et femmes dans les sociétés et communautés musulmanes ? Quelles sont les critiques féministes islamiques à l’égard de l’autorité masculine ? Quel est le contrôle du groupe familial sur la sexualité de ses membres ? Telles étaient les trois questions qui servaient de trame générale à la midi-conférence organisée par le CRIPEL (Centre régional d’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère de Liège) autour de l’analyse de l’articulation délicate entre trois thématiques dans le monde musulman : sexualité, genre et religion. Un regard en immersion en Algérie pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas… et ici.
Ghaliya Djelloul est chercheuse au Centre Interdisciplinaire d’Études de l’Islam dans le Monde Contemporain à l’UCLouvain. L’analyse qu’elle a distillée dans son exposé « Sexualité, genre et religion : le cas de l’islam », elle l’a fondée sur une recherche doctorale qu’elle a menée en Algérie à propos de l’évolution sur place des rapports de genre. Elle le précise d’emblée, son regard est celui d’une socio-anthropologue de l’islam, pas d’une islamologue qui cernerait ou justifierait des pratiques à travers une étude de l’islam et de ses textes. Ce qui l’intéresse essentiellement, ce sont les rapports de genre dans les sociétés où l’islam est implanté. Cette recherche l’a amenée à établir des constatations qu’elle pense généralisables à l’ensemble de la région et exportables à ce qui est vécu dans les pays d’accueil comme la Belgique par la partie migrante de cette population.
L’arrangement des genres
Historiquement, l’Algérie est une société à majorité islamique. Après 132 ans de colonisation, elle accède à l’indépendance en 1962. Dès ce moment, une islamisation par le haut s’y opère. L’islam y devient une religion d’État dans laquelle ce dernier s’appuie sur l’association des savants religieux pour gérer les institutions de l’éducation et, par conséquent, les programmes éducatifs. Le système politique s’appuie alors sur la religion, mais l’origine des lois n’est pas le Coran. La première fois que des lois s’appuient sur le Coran, c’est en 1984, avec l’instauration du code de la famille qui installe des mesures comme la mise sous tutelle des femmes et l’inégalité homme-femme en matière d’héritage.
Dans son analyse, Ghaliya Djelloul avance le concept d’arrangement des genres qui est à considérer sur deux niveaux : celui du rapport économique (avec notamment la reconnaissance du travail domestique de la femme) et celui de la dimension symbolique qui va justifier les rapports économiques, à savoir la notion de nécessité d’une mise en asymétrie de l’homme et la femme, et celle de légitimité de cette asymétrie. Plus concrètement, la chercheuse constate que la nécessité d’asymétrie entre hommes et femmes décroît, c’est-à-dire que la transformation de la société rend cette asymétrie de moins en moins nécessaire, dans la mesure où l’indépendance économique des femmes augmente.
Au vingtième siècle, la société algérienne passe d’une configuration majoritairement rurale (avec 80% de la population vivant hors des villes) à majoritairement urbaine (80% des gens vivant en zone urbaine, principalement dans le région côtière). Dans le même temps, la population devient majoritairement éduquée (scolarisée à 92%). En revanche, le pourcentage d’accès des femmes au marché du travail demeure le plus faible du Maghreb, passant de 4% à 17%, bien loin de celui des pays voisins où il atteint 25, voire 35%.
La volonté de maintien du patriarcat
Au niveau de la légitimité de l’asymétrie homme-femme, la tendance est l’inverse de celle observée pour la nécessité. Alors qu’elle devrait décroître, on assiste à la montée d’un discours, et même de violences qui rappellent et renforcent cette asymétrie. Ce discours « masculiniste » est porté par le courant de l’islam politique « criminalisant » la femme qui quitte l’espace domestique. Cohabitent donc une diminution du besoin de cette asymétrie homme-femme et une augmentation de la volonté de la maintenir. Et cette dernière tendance s’enracine dans une alliance entre l’État et les courants nationalistes.
Dans les années 80, suite aux problèmes économiques qui frappent le pays, l’État se retire des zones péri-urbaines où vit la population provenant des régions rurales. Dans ces zones délaissées, le courant islamiste organise la charité à partir des mosquées et conteste l’autorité de l’État. C’est dans ce contexte qu’émerge le code de la famille qui est vu comme une régression par les féministes. S’ensuit l’émergence du parti unique en 1988.
Après 2000 intervient une autre phase. Pour se légitimer, le régime intègre dans ses « clients » l’islamisme politique pour en faire les partis de l’alliance présidentielle, avec un État qui respecte l’islam et le promeut. Le patriarcat ne tient plus matériellement, mais est plus que jamais présent dans un climat qui criminalise les femmes sortant du modèle patriarcal. C’est dans ce contexte extrême qu’interviennent même des massacres de femmes accusées de pervertir les mœurs et de voler le travail des hommes parce qu’elles vivent sans mari et sans tutelle. Ces actions constituent un passage à l’acte dans la violence pour remettre la femme à la place qui était la sienne, à savoir un retour sous tutelle dans le cercle familial.
Le contrôle sur la mobilité de la femme
Ghaliya Djelloul débarque en 2014 à Alger pour son étude. Son approche s’opère à partir des facultés islamiques où elle s’aperçoit très vite qu’un dispositif informel se noue autour d’elle pour l’empêcher de sortir du cercle familial qui l’accueille. Ce dispositif est fait de propos alarmistes sur les dangers qu’elle encourt et de propositions d’accompagnement. La chercheuse se sent de plus en plus enfermée et, résistant aux injonctions, opère des sorties du cadre imparti. Face à cette volonté de la maintenir « à l’intérieur », elle se pose la question des stratégies déployées par les jeunes femmes pour conjuguer la conservation de la confiance des membres de la famille et la sortie dans les dangers supposés.
Elle se demande alors comment ces jeunes femmes s’approprient l’espace une fois au dehors (leur mobilité spatiale), mais aussi sur leur motilité, terme derrière lequel se cache la capacité de bouger (pratique effective) et la mobilité potentielle (pratique intériorisée). Son résultat principal a été d’identifier la notion de couverture/protection qui, à la voix active, signifie pour la femme porter un habit qui la couvre et, à la voix passive, veut dire être sous la tutelle (la couverture) d’un homme. En tant que norme intériorisée, cette notion s’appuie sur la vulnérabilité intrinsèque du corps de la femme et sur le sentiment de culpabilité de cette dernière. Celle-ci est renforcée par le discours religieux qui légitime le discours familial, ainsi que le maintien de la femme dans la famille et l’espace domestique.
Des stratégies de desserrement
Mais, dans ce contexte, que mettent en place la famille, le voisinage, la communauté religieuse, la société pour recadrer la mobilité des femmes ? Ghaliya Djelloul parle d’enserrement et de desserrement des femmes au sein de l’espace domestique. Ces concepts incluent deux dimensions : comment borne-t-on les champs du possible ? Et comment borne-t-on les champs du visible ? L’idée est d’obliger la femme à « rester à sa place », c’est-à-dire de reconnaître l’autorité des hommes, de rester en retrait « à sa place », de performer sa place de subordonnée. Ce dispositif commence dans la famille, puis s’étend par cercles.
La chercheuse observe aussi que le desserrement ne se fait pas uniquement par la résistance. À ce niveau, il existe plusieurs stratégies. Il y a d’abord le contournement comme sortir seule, clandestinement, mais cela augmente le risque de basculer dans une vie secrète. Il y a ensuite le détournement, comme utiliser la brèche de sorties comme l’école pour s’ouvrir à d’autres choses, les loisirs, la plage, la rencontre des jeunes hommes, etc. Et enfin, il y a le retournement, c’est-à-dire s’inscrire dans le modèle traditionnel pour obtenir plus de liberté que par l’opposition et la transgression. Élargir cette capacité spatiale est aussi une manière de prendre en mains son propre destin matrimonial.
Un changement social inéluctable
Mais qu’en est-il du lien entre sexualité, genre et religion ? La chercheuse épingle un délitement d’un modèle familial centré sur la collectivisation des ressources. Il y a un éclatement des familles au profit de petites cellules familiales, mais avec un maintien des liens et des échanges avec les réseaux familiaux. Par ailleurs, on reste dans une pratique de groupe familial. L’enjeu principal reste la reproduction du groupe, avec une vision endogame.
Dans cette configuration, la plupart des femmes essaient de passer à un modèle conjugal. Généralement, sans remise en question du mariage mais avec un mariage sous certaines conditions pour gagner en autonomie par rapport au groupe familial, plutôt que de reproduire le modèle traditionnel. Dans le même ordre d’idées, sur le plan de la sexualité, il s’agit de passer d’un modèle où la sexualité des femmes appartient au groupe à un modèle où leur corps leur appartient (en termes de mobilité, de mariage, etc.). Pour Ghaliya Djelloul, il s’agit du vrai visage du changement social, d’une marche en avant qu’elle estime inéluctable.
Dominique Watrin